21/01/2014
CUBA : LES MEDIAS FACE AU DEFI DE L'IMPARTIALITE
S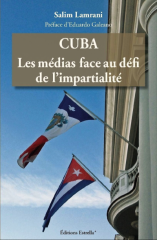 alim Lamrani, Maître de conférences à l’Université de la Réunion et journaliste spécialiste de Cuba, vient de sortir un nouvel ouvrage aux Editions Estrella avec un titre éloquent : Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité. Ce livre de 230 pages se divise en neuf chapitres. Il est introduit par une préface du grand écrivain uruguayen Eduardo Galeano, auteur du célèbre livre Les veines ouvertes de l’Amérique latine. Lamrani, comme pour tout bon historien et chercheur, enrichit toujours son travail par des sources abondantes, avec pas moins de 350 notes dans cet ouvrage. Entretien avec Salim Lamrani par André Garand, France-Cuba Marseille.
alim Lamrani, Maître de conférences à l’Université de la Réunion et journaliste spécialiste de Cuba, vient de sortir un nouvel ouvrage aux Editions Estrella avec un titre éloquent : Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité. Ce livre de 230 pages se divise en neuf chapitres. Il est introduit par une préface du grand écrivain uruguayen Eduardo Galeano, auteur du célèbre livre Les veines ouvertes de l’Amérique latine. Lamrani, comme pour tout bon historien et chercheur, enrichit toujours son travail par des sources abondantes, avec pas moins de 350 notes dans cet ouvrage. Entretien avec Salim Lamrani par André Garand, France-Cuba Marseille.
André Garand : Salim Lamrani, parlez-nous de votre dernier ouvrage.
Salim Lamrani : Ce livre part du postulat suivant : le phénomène de concentration de la presse entre les mains du pouvoir économique et financier est devenu, partout en Occident, une réalité indéniable. Or, ces médias, qui sont liés aux puissances d’argent et qui défendent l’ordre établi, sont souvent confrontés au défi de l’impartialité, surtout lorsqu’il s’agit de Cuba. Il leur est difficile de présenter de manière objective une nation dont le projet de société défie l’idéologie dominante. De plus, Cuba est, par définition, un sujet médiatique qui suscite critiques et controverses et attise régulièrement les passions.
André Garand : Quels thèmes abordez-vous dans ce livre ?
Salim Lamrani : Mon livre tente d’apporter une réponse aux questions suivantes : Comment les médias présentent-ils la réalité cubaine ? De quelle manière abordent-ils des problématiques aussi complexes que les droits de l’homme, le débat critique, l’émigration, le niveau de développement humain et les relations avec les États- Unis ? Remplissent-ils réellement leur rôle de quatrième pouvoir ? Sont-ils capables de s’émanciper du pouvoir politique, des puissances d’argent et d’apporter une vision plurielle sur la société cubaine ? Car une presse libre et indépendante est essentielle dans toute démocratie et elle s’accompagne, à l’évidence, d’un devoir de vérité informationnelle vis-à-vis des citoyens.
André Garand : Pourquoi les médias sont-ils si critiques à l’égard de Cuba ?
Salim Lamrani : Cuba, depuis le triomphe de la Révolution et l’arrivée au pouvoir de Fidel Castro, est un sujet de débat vif et animé. Il est une raison essentielle à cela : le processus de transformation sociale initié en 1959 a bouleversé l’ordre et les structures établis, a remis en cause le pouvoir des dominants et propose une alternative sociétale où – malgré tous ses défauts, ses imperfections et ses contradictions qu’il convient de ne pas minimiser – les puissances d’argent ne règnent plus en maître, et où les ressources sont destinées à la majorité des citoyens et non à une minorité.
André Garand : Eduardo Galeano, célèbre écrivain latino-américain, a rédigé la préface de votre livre.
Salim Lamrani : Eduardo Galeano a effectivement rédigé un texte incisif non dépourvu de l’humour sarcastique, si caractéristique de son style, sur Cuba et les médias. J’en profite pour le remercier chaleureusement d’avoir bien voulu associer son nom et son prestige à mon travail. J’en profite également pour remercier publiquement Estela, journaliste espagnole, qui m’a aidé dans cette tâche.
André Garand : La quatrième de couverture comporte une citation de Jean-Pierre Bel, notre Président du Sénat, qui vous remercie pour votre travail. Elle dit la chose suivante : « Merci pour ce regard sur Cuba, tellement utile ». C’est une belle reconnaissance, non ?
Salim Lamrani : Le Président Jean-Pierre Bel est un grand ami de Cuba. C’est un grand connaisseur de l’Amérique latine. Il est très attaché à la liberté d’expression et à la pluralité d’opinions. Il est issu d’une famille de résistants communistes et est un grand admirateur de la Révolution cubaine. Il a lu certains de mes ouvrages et m’a fait parvenir ce petit mot. Je l’en remercie grandement.
André Garand : Une citation de Robespierre, à qui vous dédiez votre ouvrage, introduit le livre. Pourquoi ce choix ?
Salim Lamrani : Robespierre parlait de passer la « vérité en contrebande » car il avait la conviction profonde qu’elle finirait par triompher. Je partage cette foi.
Maximilien Robespierre est le plus pur patriote de l’Histoire de France. C’est la figure emblématique de la Révolution, le défenseur de la souveraineté populaire. Il avait compris dès le départ que les puissances d’argent étaient le principal ennemi du peuple, de la République, de la Patrie. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’idéologie dominante vilipende tant son héritage. Ses aspirations à la liberté et à la justice sociale sont toujours d’actualité.
Nous vivons une époque assez curieuse. On glorifie les ennemis du peuple et on méprise ses défenseurs. Prenez la ville de Paris : Pas une rue ne porte le nom de notre Libérateur, pas une statue à l’effigie de Robespierre, alors que le traitre Mirabeau a un pont et Adolphe Thiers, le boucher de la Commune qui a fait fusiller 20.000 patriotes en une semaine, dispose d’un square et d’une statue. Rendez-vous compte, le 22 septembre, jour de la Fondation de notre République, n’est même pas célébré en France.
André Garand : Avez-vous un message à transmettre aux adhérents de France-Cuba ?
Salim Lamrani : France-Cuba est une association pour qui j’ai beaucoup de respect et d’admiration en raison sa solidarité inébranlable avec le peuple cubain. Il s’agit de la première association française de solidarité avec Cuba et on ne peut que rendre hommage au Professeur Paul Estrade, son fondateur, et féliciter tous ceux qui poursuivent son œuvre.
J’en profite pour transmettre aux adhérents de France-Cuba mes meilleurs vœux. Pour les avoir fréquentés à de nombreuses reprises lors de conférences-débats, je connais leurs qualités humaines, leur hospitalité et leur esprit combatif. J’aurai sûrement l’occasion de les rencontrer à nouveau autour de ce nouveau livre.
Cuba. Les médias face au défi de l’impartialité
Préface d’Eduardo Galeano
Paris, Editions Estrella, 2013
230 pages
18€
Disponible auprès de l’auteur : lamranisalim@yahoo.fr
Egalement en librairie : http://www.librairie-renaissance.fr/9782953128437-cuba-le...
Et chez Amazon
http://www.amazon.fr/Cuba-Medias-Face-Defi-lImpartialite/...
16:06 Publié dans Actualités, AL-Pays : Cuba, Entretien, Livre, Médias, Société | Tags : médias, cuba, impatialité, salim lamrani | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  | |
| |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Digg
Digg
09/11/2013
Bolivie : Les charognards sont à l'affut
L'été de Pau à La Paz, par Jean Ortiz. Au moment où les "Indigènes" (en Bolivie on utilise plus ce terme que celui "d'Indiens") trouvent enfin reconnaissance, considération, "protagonisme", et épanouissent leurs langues, leurs cultures, ne voilà-t-il pas qu'un recensement officiel jette un trouble inattendu.
Au précédent recensement de 2001, 38% de la population déclarait n'appartenir à aucun des 36 peuples indigènes reconnus par la Constitution. Le recensement de 2012, à première vue, indiquerait une baisse des "peuples premiers". Ils ne représenteraient que 42% de la population (les plus nombreux étant les quechuas). Ces résultats étonnants sont contestés car pour certains les questions auraient été maladroites, mal posées, les"sondeurs" inexpérimentés, le délai trop court, précipité...
Qu'à cela ne tienne: tout fait ventre pour la droite néocoloniale, "blanche", raciste, de Santa Cruz et des départements de la "demi-lune", celle qui tenta un coup de force séparatiste. Elle s'est emparée goulument de ces pourcentages pour tenter de relancer les affrontements ethniques et plaider en faveur d'une "Bolivie majoritairement métis" (entendez "blanche"), qui serait discriminée par la politique, qu'elle qualifie d'"indigéniste", du gouvernement Morales. "Finissons-en avec cette vilaine souillure indienne!" Le racisme pointe son nez, plus long que celui de Pinocchio. La droite, l'oligarchie, ont toujours considéré les Indiens comme un handicap pour le pays, quasiment comme des animaux.
Alors tout est bon contre "le gouvernement des mouvements sociaux", y compris jouer avec le "nationalisme" racial et le feu raciste. Durant des siècle la "Bolivie métis" des colonisateurs, des capitalistes, effaça les Indiens du paysage, les nia, écrasa, exploita,"esclavisa"... On appelle cela un "ethnocide". Le vice-président Linera confirme cette analyse: "parler de nation métis c'est en réalité occulter un ethnocide commis par une classe sociale; parler de nation et d'Etat boliviens et de nations culturelles indigènes originelles , paysannes, permet de faire preuve du respect et de la reconnaissance des nations ancestrales, mais aussi d'affirmer une construction commune contemporaine, que nous bâtissons ensemble autour de notre identité bolivienne".
Les résultats étonnants de ce recensement, les conditions du recensement elles-mêmes, méritent étude sereine. Le colonialisme externe et interne n'a pas désarmé; il a toujours posé les problèmes sociaux et nationaux en termes raciaux. Aujourd'hui, être Indien est devenu enfin "normal". On est passé de la revendication identitaire à sa matérialisation quotidienne, à la dignité retrouvée, à une citoyenneté épanouie. Cette émancipation porte en elle de grandes potentialités pour reconstruire le pays et penser le monde autrement. Le régime d'hier, excluant, fondé sur une prétendue hégémonie "non indienne" et la domination de classe des vieilles élites, des grands propriétaires, perd peu à peu du terrain. Hier, être Indien c'était être "archaïque", improductif, considéré comme un frein au "progrès", et mille autres lieux communs stigmatisants. Les rituels étaient quasiment clandestins, "honteux". La ritualité, aujourd'hui, n'est plus l'exclusivité des seuls "Indigènes".
Le pays se "décolonise" contre vents et marées. Le MAS et EVO MORALES ont récupéré "ce qui est communautaire, donc de tous", et une fierté nationale qui essaime. Les 36 "peuples premiers" portent désormais une révolution, et une "modernité" (qui n'est pas la nôtre, "l'occidentale", dont on sait ce qu'elle vaut). Les valeurs du "buen vivir" viennent de loin et portent loin. Il est de plus en plus difficile de caricaturer ces citoyens qui bâtissent une société où il fera bon vivre ensemble et où nul n'écrasera l'autre ni ne blessera la nature, la terre, la Pachamama (août est le mois des offrandes, du "pago", des rituels de la "wajta"). Tout cela peut expliquer sans doute pourquoi l'on se revendique désormais moins en termes d'appartenance ethnique. Qui plus est, la Bolivie n'est plus un pays majoritairement rural. Les paysans sont Indiens mais tous les Indiens ne sont pas paysans. A La Paz, ils tiennent des échoppes dans la rue, travaillent en usine ou sur les chantiers...
Beaucoup se sont prolétarisés tout en essayant de conserver leurs traditions communautaires dans leur nouveau milieu. Il n'est pas facile de recréer et faire vivre des "communautés" dans les quartiers populaires, mais les "pratiques ancestrales" restent vivantes... Un nouveau système économique où l'Etat décentralisé (trois niveaux d'autonomies) veut jouer un vrai rôle régulateur , redistributeur, ce que l'on appelle ici la transition "post-capitaliste", se consolide progressivement, malgré des tâtonnements, des conflits et les tentatives de déstabilisation de la droite "blanche". On est en période d'apprentissage, de laboratoire quotidien inédit.
Equilibre. Harmonie. Mise en commun, sont les maîtres-mots.Tout cela semble avoir brouillé les cartes. Ces premiers éléments d'analyse, à chaud, méritent une réflexion plus poussée, plus dialectique, plus fine, mais sans parti pris raciste.
14:38 Publié dans AL-Pays : Bolivie, Amérique Latine, Culture, Point de vue, Politique, Société | Tags : racisme, bolivie, jean ortiz, evo morales, chroniques vénézuéliennes | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  | |
| |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Digg
Digg
31/10/2013
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONDAMNE POUR LA VINGT-DEUXIÈME FOIS LE BLOCUS AMÉRICAIN CONTRE CUBA
 Pour la vingt-deuxième année consécutive, l’Assemblée générale a adopté aujourd’hui une résolution* sur « la nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis d’Amérique », décrété après « un différend qui a vu le jour alors que la majorité de la population actuelle n’était même pas née », a dit le représentant de la Zambie.
Pour la vingt-deuxième année consécutive, l’Assemblée générale a adopté aujourd’hui une résolution* sur « la nécessité de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à Cuba par les États-Unis d’Amérique », décrété après « un différend qui a vu le jour alors que la majorité de la population actuelle n’était même pas née », a dit le représentant de la Zambie.
Le texte a été présenté par le Ministre cubain des affaires étrangères, M. Bruno Rodriguez Parilla, qui a affirmé que le blocus avait été encore renforcé sous la présidence de M. Barack Obama, « particulièrement dans le secteur financier ». Adoptée par 188 voix pour, l’opposition des États-Unis et d’Israël et les abstentions des Palaos, des Îles Marshall et de la Micronésie, la résolution exprime la préoccupation de l’Assemblée générale face à l’adoption et à l’application de nouvelles mesures pour durcir et élargir le blocus économique, commercial et financier appliqué à Cuba.
Elle « exhorte de nouveau tous les États à s’abstenir d’adopter ou d’appliquer » de telles mesures et « demande de nouveau instamment » à tous les États de faire le nécessaire pour les abroger ou pour en annuler l’effet dès que possible.
Le Ministre cubain des affaires étrangères a confirmé que le blocus a été renforcé sous la présidence de M. Barack Obama, particulièrement dans le secteur financier. Les États-Unis, a-t-il expliqué, ont utilisé l’énorme capacité technologique de leur système d’espionnage massif, dénoncé récemment, pour persécuter et contrôler les transactions financières et les relations économiques de Cuba. Entre janvier 2009 et septembre 2013, les amendes imposées à 30 entités américaines et étrangères pour leurs relations avec Cuba ont atteint 2,446 milliards de dollars, a affirmé M. Bruno Rodriguez Parilla. Le blocus économique s’est resserré et se ressent sur les conditions de vie des familles cubaines.
Le Ministre a affirmé que Cuba ne représente en aucun cas une menace à la sécurité de « la superpuissance américaine ». Il a rappelé que son pays était disposé à établir un dialogue sérieux et constructif dans le respect de la pleine indépendance de Cuba. La reprise récente de certaines discussions sur la migration, le rétablissement de services postaux directs ou les discussions sur la lutte contre la pollution maritime ou les recherches et secours en mer montrent que cela est possible.
Les États-Unis se sont, une nouvelle fois opposés à la résolution. Leur représentant a expliqué cette position par une volonté d’appuyer le désir de la population cubaine de déterminer son propre avenir. La politique de sanction est une « mesure d’encouragement » en faveur du respect des droits civils et humains. Le représentant a affirmé qu’en 2012, plus de 2 milliards de dollars ont transité vers Cuba et que les États-Unis sont le plus grand fournisseur de produits alimentaires et agricoles de l’île.
Selon les époques, a ironisé le représentant de l’Argentine, les Gouvernements américains ont mis en avant, devant l’opinion publique, une variété d’arguments pour justifier le blocus, mais les documents des différentes administrations montrent la raison réelle de ce blocus: augmenter le désarroi du peuple cubain et transformer son désespoir en opposition au Gouvernement.
Le projet a échoué, a tranché le représentant. Les autres intervenants ont tous condamné l’embargo comme contraire à la Charte et aux relations commerciales internationales et qui a eu pour effet de ralentir fortement le développement économique de Cuba. Selon les chiffres cités par Cuba dans le rapport du Secrétaire général et repris par certains intervenants, le blocus aurait coûté depuis son origine, en 1960, 1 126 milliards de dollars à Cuba.
Les délégations ont également dénoncé la portée extraterritoriale de la loi Helms-Burton qui oblige le Gouvernement américain à prendre des sanctions contre les entreprises et personnes qui font du commerce avec Cuba. Le représentant de l’Union européenne a ainsi rappelé que la politique commerciale des États-Unis à l’égard de Cuba était par essence une question bilatérale mais que les effets extraterritoriaux de la législation américaine sont « inacceptables ». Le représentant de la Zambie a argué que l’embargo n’a pas sa place dans ce XXIe siècle, ni de rôle à jouer alors que la communauté internationale s’apprête à « préparer le terrain » du programme de développement pour l’après-2015.
Le moment est venu pour Cuba et les États-Unis de « se libérer » d’un différend qui a vu le jour pendant une époque révolue où la majorité de leur population actuelle n’était même pas née.
14:06 Publié dans Actualités, AL-Pays : Cuba, Politique, Société | Tags : onu, cuba, embargo | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  | |
| |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Digg
Digg
26/10/2013
LE SOJA D'AMERIQUE LATINE !
 Nous prenons la direction de l'Amérique Latine ce matin pour nous intéresser à la culture du soja. Longtemps critiquée pour contribuer à la déforestation de l'Amazonie, la culture du soja ne peut plus se faire n'importe comment. Mais le moratoire censé encadrer cette culture a ses limites et certains producteurs continuent de participer à la déforestation.
Nous prenons la direction de l'Amérique Latine ce matin pour nous intéresser à la culture du soja. Longtemps critiquée pour contribuer à la déforestation de l'Amazonie, la culture du soja ne peut plus se faire n'importe comment. Mais le moratoire censé encadrer cette culture a ses limites et certains producteurs continuent de participer à la déforestation.
Les pressions exercées par Greenpeace et certains clients comme Carrefour ou Mac Donald ont eu raison de la déforestation effrénée de l'Amazonie provoquée par la culture du soja. Depuis 2006 : les principaux exportateurs brésiliens refusent d'acheter du soja cultivé sur des terres déboisées. Des amendes sont prévues pour sanctionner les acheteurs qui enfreindraient la règle. Et certaines multinationales agroalimentaires comme Cargill ou ADM ont même rejoint le mouvement. De quoi assurer une culture plus respectueuse de l'environnement. De moins pour 90% de la production de soja dans le pays.
Et les 10% restant me direz-vous? Et bien c'est là que me bât blesse. 18.400 ha de forêt amazonienne restent concernés par la déforestation. La faute aux éleveurs brésiliens, de manière indirecte du moins. Bien souvent, les éleveurs brûlent des parcelles de forêt, moins chères, pour semer de l'herbe et y faire venir le bétail. Mais après quelques années, les terres sont trop dégradées pour nourrir les cheptels. Alors les éleveurs se déplacent pour brûler de nouvelles parcelles. Les cultivateurs de soja eux, prennent leur place. Et le même scénario se répète indéfiniment.
 Le deuxième problème est lui à trouver du côté des consommateurs cette fois. Et parmi eux: les Chinois ont la palme. Le pays est le premier consommateur de soja dans le monde. Sa consommation a même explosé ces trente dernières années. Mais l'explication de cette augmentation fulgurante n'est pas à trouver dans la consommation directe de soja.
Le deuxième problème est lui à trouver du côté des consommateurs cette fois. Et parmi eux: les Chinois ont la palme. Le pays est le premier consommateur de soja dans le monde. Sa consommation a même explosé ces trente dernières années. Mais l'explication de cette augmentation fulgurante n'est pas à trouver dans la consommation directe de soja.
Seuls 20% du soja importé arrive finalement dans l'assiette des Chinois sous forme de tofu, lait ou sauce d'assaisonnement par exemple. En réalité, si les Chinois ont tant besoin de soja, c'est pour nourrir le bétail. L'élévation du niveau de vie dans le pays a provoqué une hausse de la demande de viande et de poisson des chinois qui peuvent désormais s'en offrir au quotidien. Or, la Chine s'approvisionne massivement au Brésil.
Mais pas question pour les Chinois de respecter les nouvelles règles brésiliennes. Pékin a tout simplement refusé de signer le moratoire de 2006. Mais pour les producteurs brésiliens, la culture du soja, c'est une question de survie. 2% du PIB dépend de cet oléagineux. Alors pour certains, la tentation est grande d'outrepasser la règlementation en vigueur.
09:11 Publié dans Actualités, AL-Pays : Brésil, Amérique Latine, Société | Tags : soja, amérique latine, brésil, chine | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  | |
| |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Digg
Digg








