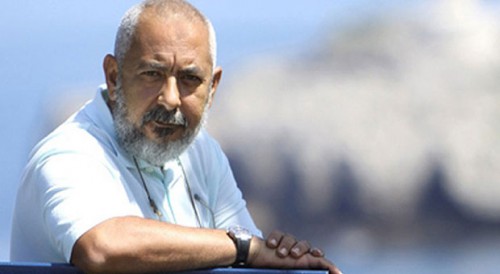01/07/2015
Maurice Lemoine. Les Etats-Unis : la fabrique de coups d’état en amérique latine
Journaliste et écrivain, spécialiste de l’Amérique Latine, ancien rédacteur en chef du « Monde diplomatique », Maurice Lemoine, qui couvre l’Amérique latine depuis quarante ans, publie une véritable enquête passionnante de 700 pages : « les Enfants cachés du général Pinochet. Précis de coups d’État modernes et autres tentatives de déstabilisation ».
« CE LIVRE EST LE RÉSULTAT DE QUATRE DÉCENNIES DE FRÉQUENTATION DU TERRAIN DES RÉSISTANCES ET DES LUTTES. »
« LE SABOTAGE ÉCONOMIQUE QUI PROVOQUE DES PÉNURIES AU VENEZUELA EST L’EXACTE RÉPLIQUE DE LA POLITIQUE APPLIQUÉE EN 1960 À CUBA. »
18:34 Publié dans AL-Pays : Argentine, AL-Pays : Brésil, AL-Pays : Chili, AL-Pays : Costa Rica, AL-Pays : Cuba, AL-Pays : Honduras, AL-Pays : Vénézuela, Amérique Latine, Livre, Politique, USA | Tags : maurice limoine, amérique latine | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  | |
| |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Digg
Digg
09/12/2014
Quand Cuba se battait pour l’Angola
Avec sa nouvelle enquête (1) « magistrale et érudite », selon les mots de Noam Chomsky, l’universitaire italo-américain Piero Gleijeses met à nu la responsabilité américaine dans la poursuite du conflit en Afrique australe après l’indépendance de l’Angola (11 novembre 1975).
Les failles de la Central Intelligence Agency (CIA) illustrent les contradictions internes aux administrations américaines, où le département d’Etat fait parfois figure d’élément modéré. Déjà auteur d’une étude riche de révélations sur l’histoire de Cuba en Afrique (2), Gleijeses s’intéresse également aux divergences tactiques entre alliés. Plus interventionniste, Cuba prend le risque de subir des représailles américaines, tandis que l’Union soviétique demeure tiraillée entre son désir de détente avec les Etats-Unis et ses engagements sur le front africain.
Rappelons les faits. En août 1975, les troupes sud-africaines occupent le sud de l’Angola, toujours province portugaise. En novembre de la même année, l’indépendance est proclamée ; les troupes sud-africaines se retirent, mais soutiennent les rebelles de l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola (Unita). Des soldats cubains viennent aider le Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) à se maintenir au pouvoir. Le Zaïre soutient quant à lui le Front de libération nationale de l’Angola (FLNA). La guerre civile fait rage.
L’administration du président Gerald Ford et son stratège Henry Kissinger avaient, dès 1974, tout mis en œuvre pour marginaliser le MPLA. Après l’élection de M. James Carter en novembre 1976, le Congrès américain adopte un amendement interdisant toute aide aux mouvements rebelles en Angola. Néanmoins, influencé par le conseiller Zbigniew Brzezinski, M. Carter se montre aussi obsédé que son prédécesseur par la présence cubaine, et refuse de reconnaître le gouvernement angolais.
Avec le président Ronald Reagan (1981-1989), qui a fait du soutien inconditionnel à l’Unita un enjeu de politique intérieure, les Sud-Africains ont les mains libres. Ne se contentant pas d’un soutien logistique, Pretoria lance une série d’opérations militaires culminant, en 1987, dans ce que l’officiel Concise History de l’armée sud-africaine définit à l’époque comme « la plus grande opération jamais menée par les forces terrestres et l’aviation sud-africaines depuis la seconde guerre mondiale ».
La bataille de Cuito Cuanavale, dans le sud-est de l’Angola (janvier 1988), est le point culminant de treize années d’agressions sud-africaines contre la plus riche des anciennes colonies portugaises. Conscient de jouer son destin en Angola, Pretoria choisit l’escalade. Et M.Fidel Castro relève le défi. En accord avec les dirigeants angolais, il décide l’envoi de troupes supplémentaires et convainc le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev de livrer des armements plus sophistiqués. En août 1988, l’Afrique du Sud se retire et accepte le plan des Nations unies pour l’indépendance de la Namibie. Cuba peut alors rapatrier ses troupes. Nelson Mandela considère l’échec sud-africain comme « le tournant dans la libération du continent du fléau de l’apartheid ». Les noms des soldats cubains morts en Angola figurent aujourd’hui avec ceux de tous les héros de l’histoire sud-africaine sur le mur du souvenir du Freedom Park, à Pretoria.
L’histoire de la colonisation en Afrique est scandée par d’autres guerres, celles qui ne disaient pas leur nom et se contentaient de tout subordonner à la quête de profit. En 1903, une campagne internationale lancée par un journaliste britannique, Edmund Morel, dénonce comme criminelles les conditions de travail dans les exploitations de caoutchouc dans l’Etat indépendant du Congo, futur Congo belge. Pierre Savorgnan de Brazza est envoyé enquêter au Congo français, dont il avait été commissaire général de 1886 à 1897. Le rapport Brazza, rédigé en 1907, accable l’administration, jugée inefficace, dominée par des intérêts privés et couvrant des abus « intolérables et massifs ». On doit à l’historienne Catherine Coquery-Vidrovitch l’exhumation de ce texte oublié, qui fut jugé trop compromettant pour être publié (3).
Augusta Conchiglia
(2) Piero Gleijeses, Conflicting Missions : Havana, Washington and Africa, 1959-1976, The University of North Carolina Press, 2002.
(3) Le Rapport Brazza. Mission d’enquête du Congo : rapport et documents (1905-1907), préface de Catherine Coquery-Vidrovitch, Le Passager clandestin, Neuvy-en-Champagne, 2014, 305 pages, 19 euros.
11:04 Publié dans AL-Pays : Cuba, Histoire, Livre, Politique | Tags : cuba, angola, histoire | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  | |
| |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Digg
Digg
24/11/2014
Leonardo Padura « Je suis et resterai un indécrottable Cubain »
Leonardo Padura était en France pour présenter son dernier livre Hérétiques. En observateur scrupuleux, il parle sans tabou et sans langue de bois de son pays et de son histoire.
Votre roman Hérétiques, au-delà de la question du dogme, questionne la notion de liberté, de l’individu ou du groupe ...
LEONARDO PADURA La liberté est un élément essentiel de la condition humaine. Nul ne cesse d’être libre volontairement et la privation de liberté est liée à des circonstances extérieures, pas que politiques. Cela a à voir avec l’épanouissement de l’individu. Je ne voulais pas cantonner le livre au seul angle politique. Je voulais que les dimensions humaines, sociales et philosophiques soient les fils conducteurs de cette histoire.
Peut-on dire que c’est le roman d’une certaine désillusion ?
LEONARDO PADURA D’une désillusion intergénérationnelle. L’histoire met en scène deux générations qui se suivent et vivent une expérience totalement différente. Mario Conde (le détective, personnage récurrent dans les écrits de Padura – NDLR) a cru à la révolution. Il y a participé jusqu’au moment où l’édifice s’est effondré sous ses pieds dans les années quatre-vingt-dix. Conde, comme tous ses concitoyens, a subi de plein fouet les pénuries et, dans un même mouvement, découvert la réalité du « socialisme réel ». Judit est née dans ces années-là et n’a pas vécu cette histoire. On mesure, entre l’itinéraire de ces deux personnages, l’évolution de la société cubaine. Tous les interdits de la génération de Conde n’existent plus. La génération actuelle est plus libre. Elle vit dans un pays plus chaotique, mais il est plus facile de s’épanouir personnellement. Conde ne comprend pas très bien cette jeunesse mais, avec son intelligence, son intuition, il tente de le faire.
Vous brossez le portrait de cette jeune génération qui se retrouve le soir, Avenida G, en déshérence...
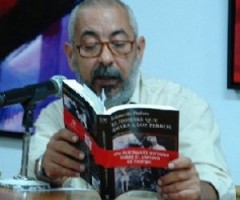 LEONARDO PADURA La jeunesse, en général et d’où qu’elle soit, a peu conscience du futur.
LEONARDO PADURA La jeunesse, en général et d’où qu’elle soit, a peu conscience du futur.
Elle vit l’instant, le temps présent. Et cette jeunesse qui se retrouve Avenida G essaie de vivre dans un pays compliqué, économiquement asphyxié. Ce qui, du temps de Conde, procédait d’une logique cartésienne, dans le sens où la société organisait une vision d’avenir s’est effondré peu à peu. Voilà pourquoi les jeunes Cubains ne regardent pas l’avenir comme leurs aînés, parce que, la plupart du temps, ils n’ont pas d’avenir. Cela se traduit par une irrépressible envie de partir, au point que quitter l’île devient une solution pour son accomplissement personnel. Ceux qui émigrent sont les jeunes les plus instruits, formés. C’est une perte énorme pour le présent et le futur du pays.
On a le sentiment, à vous lire, que cette jeunesse fait partie d’une petite bourgeoisie qui ne dirait pas son nom...
LEONARDO PADURA Je ne crois pas. Certains sont capables de se priver de nourriture pour pouvoir se payer des fringues griffées. Ils ont deux paires de chaussures, de la marque Nike ou Converse quand la génération de Conde en avait une seule, la même pour tous. Et posséder des baskets de marque, aujourd’hui, c’est devenu une question vitale pour ces jeunes gens.
Dans l’Automne à Cuba, où il est question d’un vrai-faux tableau de Matisse, le ton était différent. On vous sent plus mélancolique dans Hérétiques...
LEONARDO PADURA Ce roman est effectivement plus dramatique. Mais ce n’est pas dû qu’à l’environnement, à la société. Conde a vieilli. Il est plus fatigué, plus désenchanté. Il doit gagner sa vie comme il peut depuis qu’il n’est plus flic. Son regard sur la vie s’en ressent.
Mario Conde serait-il nostalgique ?
LEONARDO PADURA Quand tu as cinquante ans, la nostalgie est un élément intrinsèque de ta vie. Tu éprouves la nostalgie de l’époque où tu pouvais toucher tes pieds avec tes mains. Quand tu avances dans la vie, tu idéalises le passé. Avec le recul, je mesure que ma génération, celle des années 1980, a connu beaucoup d’opportunités, mais nous ne le savions pas. Certes, il se passait des choses graves, mais je me souviens de cette époque comme la plus heureuse de ma vie. Je crois que c’est la même chose pour Conde.
Il lui reste l’amitié. Celle qui traverse les époques, résiste à tout...
LEONARDO PADURA. Sans ses amis, sans ces personnes avec qui il partage sa vie, Conde ne serait pas le même homme. Ils se retrouvent autour d’un rituel, celui du sentiment d’immortalité que procure l’amitié, un rituel vital à l’intérieur de ce cercle qu’ils se sont créé pour vivre et survivre. Cela correspond au sentiment grégaire qui nous singularise. Le Cubain vit en groupe. Chaque acte de sa vie participe de cette socialisation, c’est une pratique culturelle innée. Chez les adolescents, on peut y voir de la spontanéité. Ils se déplacent en groupe, font tout en groupe. Peut-être que Conde et sa bande sont restés d’éternels adolescents!
« L’art est pouvoir », écrivez-vous. Pouvoir ou contre-pouvoir?
LEONARDO PADURA Si on en a une lecture politique, il est un contre-pouvoir. Si on en a une lecture esthétique, humaine, il est pouvoir. L’art a le pouvoir d’attraper la vie, de créer la beauté, de la communiquer. Qu’un tableau du XVIe siècle soit admiré depuis sa création, c’est un sacré pouvoir, non?
Les artistes seraient-ils dangereux?
LEONARDO PADURA Non, ils sont nécessaires. Si l’art n’existait pas, il n’y aurait pas de civilisation. L’expression de l’esprit à travers l’art est l’un des grands buts de l’humanité et l’une des manifestations de civilisation. Une oeuvre d’art ne change pas le réel. Elle nous aide à l’appréhender, à le comprendre dans sa continuité historique.
Parlons de Cuba...
LEONARDO PADURA C’est un pays complexe, difficile d’expliquer. Il faut connaître sa réalité pour le comprendre. Et encore... Beaucoup de contrastes traversent les strates de la société. Depuis deux cents ans, depuis que Cuba est indépendante, la présence, l’importance, le rayonnement de la création artistique dépasse de loin la taille de l’île. Cuba a fourni des poètes, des écrivains, des peintres, des musiciens au monde entier. Je lis en ce moment les Rois du mambo d’Oscar Hijuelos. Je mesure l’apport de la présence des musiciens cubains à Paris dans les années trente. C’est passionnant. Ajoutez à cet environnement culturel fort un facteur politique majeur: Cuba est le seul pays de la région à avoir vécu une révolution. Qui dit révolution dit changement, passions en mouvement. Nous avons traversé une période de restrictions et nous ignorons quel sera notre futur. En 2018, Raul Castro devrait laisser le pouvoir. Qui va lui succéder ? Que va-t-il succéder?
Quel Cubain êtes-vous?
LEONARDO PADURA Je n’ai jamais été effleuré par l’idée d’immigrer, même quand je n’avais plus un sou en poche parce que j’appartiens à ce monde. Cela ne veut pas dire que je n’aime pas voyager... Je vis dans la maison où je suis né. Ma femme et moi vivons dans cette maison construite par mon père, dans ce même quartier de La Havane, Mantilla, où mon grand-père et mon arrière-grand-père vivaient. J’ai une relation passionnée avec cette géographie et ces personnes. J’ai la chance d’avoir été publié dans le monde entier, et à Cuba, bien sûr. D’avoir gagné des prix prestigieux, mais là où humainement je me retrouve, c’est ici, à Cuba. Je suis ce lieu et ce lieu est moi.
Vous avez la citoyenneté espagnole...
LEONARDO PADURA On me l’a offerte. J’ai la double nationalité. Mais je suis un indécrottable Cubain et je le resterai toujours.
L'Humanité : http://www.humanite.fr/leonardo-padura-je-suis-et-resterai-un-indecrottable-cubain-553567#sthash.SFih0Nb3.dpuf
16:48 Publié dans AL-Pays : Cuba, Culture, Livre | Tags : leonardo padura, cuba, livre, les hérétiques | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  | |
| |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Digg
Digg
05/11/2014
L’Haïtienne Yanick Lahens prix Femina 2014 avec «Bain de lune»
C’est l’écrivaine Yanick Lahens qui a décroché ce lundi 3 novembre le prix Femina 2014 pour son roman Bain de lune. Le jury exclusivement féminin couronne ainsi une œuvre poétique et politique qui témoigne de la beauté et de la tragédie qui habite le petit État caribéen. Le prix Femina étranger a été décerné à l’Israélienne Zeruya Shalev pour Ce qui reste de nos vies.
« Je suis très contente. La reconnaissance fait du bien et je suis surtout sensible au fait que le jury a compris que cette histoire, si elle se passe en Haïti, est universelle », a déclaré la lauréate après l’annonce du jury.
Ce sont quatre générations de deux familles et la vie des paysans qui défilent sur 280 pages devant nos yeux. Yanick Lahens a longtemps labouré la terre haïtienne pour faire naître Bain de lune. En Haïti, « vivre et souffrir sont une même chose » nous fait comprendre la narratrice du roman, une inconnue échouée sur une plage. Ici on lutte aussi bien contre la politique des dictateurs que contre les colères de la nature qui s’expriment par des tremblements de terre, des ouragans ou des sécheresses : « Dans toute cette histoire, il faudra tenir compte du vent, du sel, de l’eau, et pas seulement des hommes et des femmes. »
Bain de lune, c’est aussi un combat contre le poids de la généalogie et l’histoire de deux camps, les Lafleur et les très redoutés Mésidor, devenus les seigneurs de l’île : « Remonter toute la chaîne de mon existence pour comprendre une fois pour toutes… Remettre au monde un à un mes aïeuls et aïeules. Jusqu’à l’aïeul franginen, jusqu’à Bonal Lafleur, jusqu’à Tertulien Mésidor et Anastase, son père. »
Un style direct et tranchant
Née le 22 décembre 1953 à Port-au-Prince, Yanick Lahens dépeint ainsi les forces extérieures et intérieures qui sont à l’œuvre dans son pays natal. La beauté des paysages et des gestes, les bains de lune et le chant vaudou, la cruauté d’une existence très dure et d’une politique bien souvent cynique, tout passe par le style direct et tranchant, à la fois empathique et distancé de l’auteur.
Yanick Lahens a fait ses études secondaires et supérieures en France avant de s’installer à nouveau en Haïti pour enseigner la littérature et s’engager contre l’illettrisme. Une action qui l’avait mené aussi dans le cabinet du ministre de la Culture, Raoul Peck, de 1996 à 1997. Cofondatrice de l’Association des écrivains haïtiens, elle est membre du Conseil international d’études francophones et s’affirme aujourd’hui comme une parmi les grandes figures de la littérature haïtienne.
Article publié par RFI
19:27 Publié dans AL-Pays : Haiti, Culture, Livre, Société | Tags : l’haïtienne yanick lahens prix femina 2014 «bain de lune» | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer |
Imprimer |  |
| ![]() Facebook | | |
Facebook | | |  | |
| |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  Digg
Digg